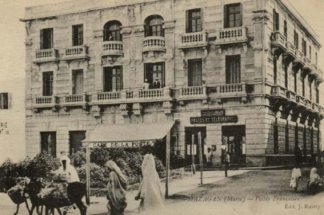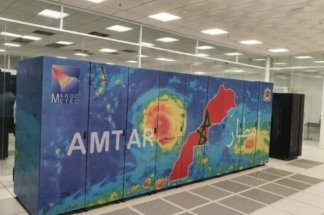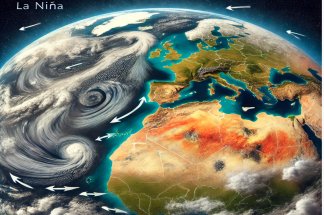Environnement
Refroidir sans réchauffer la planète : la grande transition de la climatisation

18 avril 2025 montre une vue générale d'unités de climatisation installées sur la façade d'un immeuble à New Delhi. Le marché indien des climatiseurs devrait passer de 14 millions d'unités actuellement à 30 millions d'unités en termes de volume d'ici à 2030,. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
Face à l’explosion de la demande en climatisation dans un monde en surchauffe, l’humanité se retrouve à la croisée des chemins. Entre innovations technologiques prometteuses, alternatives durables déjà en action et dépendance accrue à des systèmes énergivores, la bataille pour se rafraîchir sans aggraver le dérèglement climatique s’annonce décisive.
Le modèle de l’ONU : climatiser en puisant dans l’eau
Depuis plus de 70 ans, dans les sous-sols du siège des Nations unies à New York, un système unique pompe jusqu’à 26 000 litres d’eau par minute dans l’East River pour climatiser les bâtiments du complexe. Conçu dès les années 1950 et modernisé entre 2008 et 2014, ce système repose sur une double boucle d’eau évitant toute contamination, et utilise moins d’énergie qu’un système de climatisation classique.
David Lindsay, responsable de l’installation, souligne que la température stable de la rivière permet de réduire considérablement la consommation électrique, même en été. Le dispositif est discret mais efficace : difficile de deviner, depuis l’Assemblée générale ou les bureaux vitrés, que l’East River est plus qu’un simple décor.
Ce type d’hydrothermie est aussi utilisé dans d'autres antennes onusiennes. À Genève, le Palais des Nations utilise les eaux du lac Léman, tandis que le centre onusien de Copenhague puise l’eau de mer pour sa climatisation, réduisant ainsi quasi intégralement son besoin en électricité pour le refroidissement.
Des solutions efficaces, mais encore trop rares
Alors que la planète se réchauffe, la demande en climatisation explose : le monde compte aujourd’hui 2 milliards de climatiseurs, un chiffre voué à doubler d’ici 2050. Or ces systèmes traditionnels, fortement consommateurs d’électricité et souvent équipés de réfrigérants nocifs, représentent une part croissante des émissions mondiales de CO₂.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) note que la consommation énergétique liée à la climatisation a triplé depuis 1990. Des alternatives existent : géothermie, réseaux de froid urbains, ou encore hydrothermie comme à Paris où la Seine refroidit des bâtiments emblématiques dont le Louvre. Pourtant, ces solutions restent marginales.
Selon Lily Riahi, coordinatrice de la Cool Coalition de l’ONU-Environnement, « le frein n’est pas technique, mais institutionnel et logistique ». Les projets nécessitent des investissements coordonnés, un portage politique fort, et une vision de long terme impliquant collectivités, entreprises et citoyens.
Le défi de l’innovation : des réfrigérants solides pour une clim plus propre
Dans son laboratoire de l’université de Cambridge, le professeur Xavier Moya expérimente depuis 15 ans une révolution potentielle : la climatisation sans gaz. À la place, des matériaux barocaloriques — des cristaux capables de varier de température sous pression — pourraient devenir la prochaine génération de réfrigérants.
Contrairement aux gaz actuels, ces matériaux ne s’échappent pas, sont plus écologiques, et possiblement plus économes en énergie. Les premiers prototypes développés par la startup Barocal, issue du laboratoire de Cambridge, ont déjà permis de refroidir des canettes de soda. Le défi est désormais de miniaturiser et de rendre ces systèmes compétitifs en termes de bruit et de coût.
Soutenue par le Conseil européen de l’innovation et Breakthrough Energy (fondé par Bill Gates), Barocal prévoit un premier lancement commercial dans trois ans, ciblant d’abord les centres commerciaux, entrepôts et écoles, avant de viser le marché résidentiel.
L’Inde : entre nécessité sociale et bombe climatique
Mais à l’autre bout du spectre, le cas de l’Inde illustre un paradoxe brûlant. Avec des étés de plus en plus longs et extrêmes — jusqu’à 49,2°C à New Delhi — la climatisation devient une question de survie. Seulement 7 % des foyers indiens sont équipés, mais les ventes progressent à un rythme effréné, passant de 14 à 30 millions d’unités annuelles prévues d’ici 2030.
Pour des millions d’Indiens comme Aarti Verma, commerciale à Delhi, le climatiseur est devenu un investissement vital. "Je veux juste un peu de confort quand je rentre", dit-elle. Mais cette démocratisation a un coût environnemental massif : production d’électricité (souvent à base de charbon), fuites de gaz réfrigérants, et accentuation des îlots de chaleur urbains.
L’ONU-Environnement estime que les climatiseurs représenteront 25 % des émissions de CO₂ de l’Inde d’ici 2050, et absorberont près de la moitié de sa demande énergétique. Le pays n’a toujours pas signé l’Engagement mondial pour le refroidissement, un accord visant à limiter l’impact climatique du secteur.
Une transition incontournable, mais inégale
Ce panorama mondial du refroidissement met en lumière une urgence : celle d’une transition climatique juste. Si les grandes organisations ou certaines villes pionnières peuvent investir dans des technologies sobres et durables, des centaines de millions de personnes dans les pays en développement doivent encore choisir entre confort thermique et impact environnemental.
Or le combat climatique ne pourra être gagné que si l’innovation devient accessible et adaptée à tous les contextes. Les climatiseurs à basse consommation, les réfrigérants non polluants, les réseaux urbains de froid, et la législation sur les températures minimales sont autant d’outils à généraliser.
Dans ce domaine, les entreprises ont un rôle central à jouer. Des fabricants comme Daikin en Inde, ou les start-ups européennes comme Barocal, cherchent à conjuguer performance, prix et impact environnemental réduit. La standardisation des notations énergétiques, l’éco-conception et les incitations à l’achat de systèmes efficaces s’imposent comme des leviers clés.
Refroidir la planète sans la chauffer : un défi collectif
La transition vers une climatisation durable n’est pas qu’une affaire de technologie. C’est aussi un enjeu de gouvernance, de planification urbaine, de justice sociale et d’éducation à l’usage. Comme le rappellent les experts de l’AIE, la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas : l’isolation des bâtiments, l’architecture bioclimatique ou encore les solutions de ventilation naturelle doivent compléter le tableau.
Au siège de l’ONU comme dans une échoppe de Delhi, la quête de fraîcheur incarne une tension fondamentale du XXIe siècle : comment concilier confort individuel et responsabilité collective. Les réponses existent, mais elles exigent que l’ensemble des acteurs — États, entreprises, chercheurs et citoyens — participent activement à la refonte de notre rapport au froid. (Quid avec AFP)