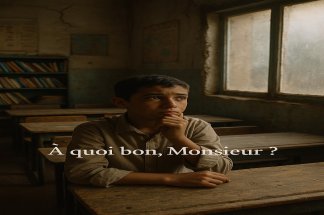National
Un démarrage sur les nerfs pour une campagne électorale prématurée - Par Bilal Talidi

Deux événements politiques majeurs ont marqué le lancement prématuré de la campagne électorale cette année. Le premier concerne la manière dont a été abordé le congrès du Parti de la justice et du développement (PJD), le second événement est la tournée régionale du Rassemblement national des indépendants (RNI), entamée à Dakhla sous l’intitulé « Itinéraire des réalisations »
À peine amorcée, la campagne électorale au Maroc s’enlise déjà dans les travers du passé : polarisations binaires, attaques personnelles et instrumentalisation de la cause palestinienne, constate Bilal Talidi pour lequel le débat politique reste prisonnier de logiques tactiques et d’ambitions à court terme, éloignant un peu plus les citoyens d’un choix éclairé et d’un véritable projet collectif.
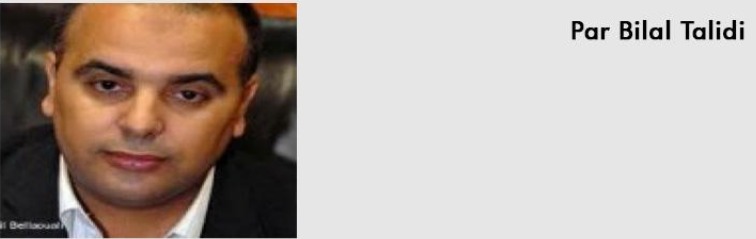
Deux événements politiques majeurs ont marqué le lancement prématuré de la campagne électorale cette année. Le premier concerne la manière dont a été abordé le congrès du Parti de la justice et du développement (PJD), aussi bien par sa propre direction que par ses adversaires. Au cœur de la polémique : une altercation verbale virulente initiée par le secrétaire général du PJD à l’encontre de ceux qui contestent la hiérarchisation des priorités politiques, notamment à travers le slogan controversé « Taza avant Gaza », opposant la cause nationale à la cause palestinienne, sans oublier ses sorties répétées contre les chef de la majorité Aziz Akhannouch.
Le second événement majeur est la tournée régionale du Rassemblement national des indépendants (RNI), entamée à Dakhla sous l’intitulé « Itinéraire des réalisations ». Cette campagne n’a pas manqué de viser frontalement le PJD, multipliant les critiques à l’encontre de sa direction.
La campagne du RNI repose sur deux axes principaux : d’une part, promouvoir l’idée d’un second mandat, vantant sa capacité à diriger ce qu’il appelle le gouvernement du « Mondial » (en référence à la Coupe du monde 2030), et à concrétiser les grands projets royaux, notamment en matière d’État social ; d’autre part, dénoncer le bilan du PJD, et plus particulièrement de ses dirigeants, accusés d’incarner « l’échec politique », selon les termes d’Aziz Akhannouch, président du RNI.
Confusion et contradictions au sein de la majorité
Sur le fond, ce débat politique semble nécessaire à l’approche des consultations électorales. L’effervescence d’une campagne implique une confrontation d’idées, un bilan défendu par le gouvernement et une critique argumentée par l’opposition. Et cette dynamique, dans une certaine mesure, est bien présente. Mais plusieurs éléments montrent que cette campagne anticipée s’engage sur de mauvaises bases, tant du point de vue politique que communicationnel.
Première dérive : la confusion au sein de la majorité gouvernementale, où certains partis adoptent une posture d’opposition. Ainsi, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal s’est exprimé avec force contre la flambée des prix, les programmes Maroc Vert et Maroc Bleu, le soutien gouvernemental à l’importation d’ovins, de bovins et de viande, ou encore la hausse du prix des carburants.
Même attitude du côté du Parti Authenticité et Modernité (PAM), qui n’a pas hésité à critiquer ces mêmes mesures, notamment les aides accordées aux importateurs de viande, comme s’il cherchait à se désolidariser du RNI, son partenaire de coalition, et à éviter de porter la responsabilité des politiques auxquelles il a pourtant activement contribué.
Or, la logique voudrait que les partis de la majorité respectent un devoir de solidarité gouvernementale, en assumant collectivement et loyalement les actions entreprises, plutôt que de rejeter sur l’un de leurs alliés le poids des décisions impopulaires.
Déficit de clarté et durcissement du discours
Autre signe d’un manque de sérieux dans la communication politique : le refus des partis de la majorité de répondre aux accusations de clientélisme, de conflits d’intérêts et de mauvaise gestion des aides publiques. Lorsqu’il a été proposé de créer une commission d’enquête parlementaire sur les subventions aux importateurs de bétail et de viande, ces partis lui ont préféré une simple mission exploratoire, vidée de toute portée contraignante.
Les demandes d’éclaircissements sur certaines déclarations polémiques, émanant de figures de la majorité, ont également été éludées. C’est le cas de la secrétaire d’État à la pêche maritime, Zakia Driouch, qui a évoqué un financement public conséquent en faveur d’un homme d’affaires membre du RNI, pour la création d’une écloserie de mollusques. Plutôt que d’expliquer les critères de cette subvention, elle s’est contentée d’indiquer qu’il s’agissait d’un programme de soutien à l’aquaculture, financé par des partenaires internationaux, sans justification des critères de sélection ni des mécanismes de contrôle.
Ce déficit de transparence s’ajoute à une radicalisation du discours politique, notamment chez les dirigeants du PJD. Le ton employé par leur secrétaire général a suscité de vives critiques, y compris au sein de son propre parti. Plusieurs cadres ont exprimé leur malaise face à un langage qualifié de « verbalement agressif », soulignant l’incompatibilité de ce style avec la référence islamique revendiquée par le parti. Un appel interne à un retour à un discours plus apaisé et conforme aux valeurs fondatrices du PJD a même été formulé.
-En somme, ce démarrage prématuré de la campagne électoral laisse entrevoir un paysage politique marqué par la confusion stratégique, l’absence de lignes claires au sein de la majorité, un discours parfois dégradé et une instrumentalisation dangereuse de thématiques sensibles.
Le climat pré-électoral aurait gagné en clarté et en hauteur de vue si les débats se concentraient sur les véritables enjeux de la gouvernance future : quelle vision pour le Maroc de 2026 ? Comment affronter les défis géostratégiques régionaux, les engagements liés à l’organisation du Mondial 2030, ou encore l’ambition de renforcer le rôle du Royaume comme puissance régionale en Afrique ?
À défaut de cette perspective collective, les logiques de positionnement partisan risquent de primer, au détriment d’un débat public structurant et utile pour les électeurs.
Un retour inquiétant à la logique binaire de 2016
La tentation de reproduire le schéma de polarisation électorale observé en 2016 semble se dessiner à nouveau à l’horizon des élections à venir. Cette fois, le duel annoncé oppose le Rassemblement national des indépendants (RNI) au Parti de la justice et du développement (PJD), à l’image du clivage qui avait dominé les élections de 2016 entre le PJD et le Parti authenticité et modernité (PAM).
Ce rétrécissement du champ politique à deux pôles risque de fausser la lecture démocratique du paysage partisan, de réduire les choix des citoyens et de reléguer au second plan d’autres acteurs politiques — qu’ils soient membres de la majorité ou de l’opposition. En misant tout sur le RNI, responsable du bilan gouvernemental, pour le positionner face au PJD, ce face-à-face occulte la diversité des courants et des offres politiques, et brouille la compréhension des électeurs quant aux véritables responsabilités de chaque parti.
La personnalisation du débat : un danger pour la démocratie
Autre dérive préoccupante : la personnalisation excessive de la compétition électorale. Réduire la campagne à des affrontements entre individus, figures partisanes ou responsables politiques dénature le sens même de la démocratie représentative. Ces luttes d’image et de symboles, souvent amplifiées sur les réseaux sociaux, alimentent le populisme et appauvrissent le débat public.
Une telle approche dessert la politique et nuit à l’image du pays, en faisant glisser le débat électoral vers l’animosité personnelle au lieu d’un affrontement argumenté sur les projets, les programmes et les visions d’avenir. Or, une véritable confrontation électorale devrait être portée par une rationalité forte, structurée autour de bilans, de critiques fondées et de propositions concrètes — autant d’éléments que l’électeur attend pour faire un choix éclairé.
Palestine et politique intérieure : un amalgame à éviter
Parmi les signaux les plus alarmants du lancement prématuré de la campagne, figure l’instrumentalisation de la cause palestinienne, qui tend à diviser artificiellement le débat en deux camps : celui du soutien à la résistance et celui du soutien à la normalisation. Une telle dichotomie est dangereuse, car elle dépasse les clivages partisans réels, ce différend n’étant, dans les faits, qu’un désaccord entre un parti et quelques figures civiles isolées, et non un enjeu de conflit politique majeur entre les partis marocains.
Le risque est double : d’une part, ce glissement détourne l’attention du véritable débat, à savoir les politiques publiques internes, cœur de la confrontation démocratique entre majorité et opposition ; d’autre part, il peut être interprété comme une remise en cause de la position officielle de l’État marocain, qui jusqu’à présent a su maintenir un équilibre stratégique et diplomatique reconnu, sans que cette posture ne fasse l’objet d’un rejet explicite par aucun parti.
Où est la vision ? Une campagne sans horizon stratégique
En définitive, cette campagne électorale prématurée pourrait offrir un espace de réflexion collective sur les grands défis de la prochaine législature. Or, aucun parti pour l’instant ne semble s’y engager avec la hauteur requise. Le débat aurait dû se concentrer exclusivement sur la vision que les forces politiques se font du gouvernement de 2026, appelé à affronter des enjeux majeurs :
- La gestion de la cause nationale et de l’intégrité territoriale ;
- La stabilité régionale dans un contexte de tension croissante avec l’Algérie ;
- L’organisation de la Coupe du monde 2030, qui implique une coordination institutionnelle et logistique hors norme ;
- La transition vers un Maroc puissance régionale en Afrique;
- Et bien d’autres défis liés à la consolidation de l’État et à la gouvernance institutionnelle.
Or, les partis semblent prisonniers d’une logique électoraliste classique, où la recherche de sièges l’emporte sur la construction d’une vision d’ensemble. On observe peu de tentatives pour imaginer des alliances programmatiques solides, sur des bases idéologiques ou de complémentarité stratégique.
Une telle démarche aurait pourtant permis d’éviter la polarisation stérile, de préserver la pluralité du débat, et de garantir une meilleure lisibilité démocratique. En son absence, le risque est grand de voir l’après-élections marqué par des blocages politiques — voire constitutionnels — qui compliqueront la formation du prochain gouvernement.