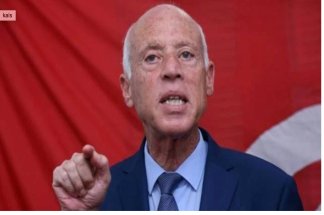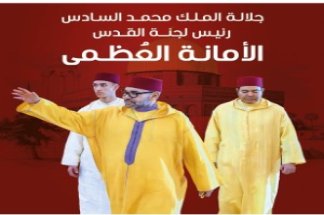International
Les dépenses militaires mondiales : moins de beurre et plus de canons - Par Abdeslam Seddiki

Les dépenses militaires des États-Unis ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 997 milliards de dollars, soit 66 % des dépenses totales de l’OTAN et 37 % des dépenses militaires mondiales contre environ 314 milliards de dollars pour la Chine qui a augmenté ses dépenses de 7 %
Les dépenses militaires mondiales ont atteint un record historique de 2 718 milliards de dollars en 2024, selon le SIPRI. Des hausses spectaculaires sont observées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, relève Abdeslam Seddiki qui note que l’Algérie se distingue avec des dépenses quatre fois supérieures à celles du Maroc. Dans ce marché ultra-concentré, dominé par une poignée de grandes puissances, la course aux armements s’accélère à l’échelle planétaire.
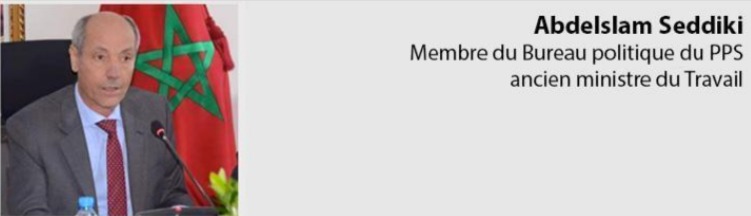
Les dépenses militaires, exprimées en termes réels, incluent toutes les dépenses publiques pour les forces armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais de fonctionnement, les achats de matériel militaire et d’armes, les infrastructures militaires, la recherche et développement, l’administration centrale, le commandement et le soutien. Par conséquent, « les dépenses d’armement » ne constituant qu’une partie des dépenses militaires.
Sur cette base, le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) publie annuellement depuis 1988 un rapport sur les dépenses militaires dans différents pays. Ainsi, d’après le rapport 2024 publié le 26 avril dernier, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à 2023. La plus forte hausse annuelle jamais enregistrée depuis au moins la fin de la guerre froide. Ces dépenses ont augmenté dans toutes les régions du monde, avec une hausse particulièrement rapide en Europe et au Moyen-Orient. Et pour cause ! Les cinq plus grands dépensiers – États-Unis, Chine, Russie, Allemagne et Inde – concentrent 60 % du total mondial, avec des dépenses combinées s’élevant à 1 635 milliards de dollars.
Les USA et la Chine réalisent près de la moitié des dépenses mondiales.
Les dépenses militaires des États-Unis ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 997 milliards de dollars, soit 66 % des dépenses totales de l’OTAN et 37 % des dépenses militaires mondiales en 2024. Une part importante du budget américain est consacrée à la modernisation des capacités militaires et de l’arsenal nucléaire afin de maintenir un avantage stratégique sur la Russie et la Chine. Les membres européens de l’OTAN ont dépensé 454 milliards de dollars, soit 30 % du total des dépenses de l’alliance
La Chine, deuxième plus grand dépensier militaire au monde, a augmenté ses dépenses de 7 %, pour atteindre environ 314 milliards de dollars, marquant ainsi trois décennies d’augmentations consécutives. La Chine représente 50 % de toutes les dépenses militaires en Asie-Océanie, investissant dans la modernisation continue de son armée et dans le renforcement de ses capacités en matière de cyberguerre et d’arsenal nucléaire.
Les dépenses militaires de la Russie ont atteint environ 149 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2023 et le double du niveau de 2015. Cela représente 7,1 % du PIB russe et 19 % de l’ensemble des dépenses publiques russes. Les dépenses militaires totales de l’Ukraine ont augmenté de 2,9 % pour atteindre 64,7 milliards de dollars, soit l’équivalent de 43 % des dépenses de la Russie. Avec 34 % du PIB, l’Ukraine enregistrait le fardeau militaire le plus lourd de tous les pays en 2024.
Les dépenses militaires de l’Allemagne ont augmenté de 28 % pour atteindre 88,5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand dépensier d’Europe centrale et occidentale et le quatrième au monde.
Les dépenses militaires de l’Inde, cinquième plus grand dépensier au monde, ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 86,1 milliards de dollars.
Les dépenses militaires au Moyen-Orient s’élèvent à environ 243 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023 et de 19 % par rapport à 2015. Israël y consacre 46,5 milliards de dollars, soit 8,8% du PIB, en augmentation de 65% ! L’Arabie saoudite est le plus grand dépensier du Moyen-Orient en 2024 et le septième au monde. Ses dépenses militaires ont connu une modeste augmentation de 1,5 %, atteignant environ 80,3 milliards de dollars, mais toujours inférieures de 20 % à celles de 2015, année où les revenus pétroliers du pays avaient atteint leur pic.
L’Algérie dépense 4 fois plus que le Maroc !
Les dépenses militaires en Afrique ont atteint 52,1 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2023 et de 11 % par rapport à 2015. L’Afrique du Nord concentre à elle seule plus de la moitié de ce montant, avec 30,2 milliards de dollars, en augmentation de 8,8 % par rapport à l’année précédente. Deux pays dominent cette tendance : l’Algérie et le Maroc, qui représentent ensemble près de 90 % des dépenses militaires nord-africaines. Il faut préciser que l’Algérie dépense 4 fois plus que le Maroc, soit 21,8 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars pour le Maroc. Par rapport au PIB, les taux sont respectivement de 8,8% et 3,8%.
L'Algérie était le 21ème plus grand importateur d'armes au monde de 2020 à 2024. Bien que les importations en provenance de Russie aient chuté de 81% entre 2015-2019 et 2020-2024, ce pays demeure son principal fournisseur avec presque la moitié (48 pour cent) des importations d'armes de l'Algérie, suivie par la Chine (19 %) et l'Allemagne (14%). Les importations les plus significatives en 2020-2024 étaient des véhicules blindés (33 %), des avions (29 %) et des navires (21 %). Parmi les avions, neuf chasseurs russes, quatre avions de transport américains et six drones armés chinois sont connus pour avoir été livrés.
Les importations d'armements du Maroc ont pour leur part diminué de 26 % entre 2015-2019 et 2020-2024 après avoir atteint leur apogée entre 2010 et 2014, ayant augmenté de plus de 10 fois par rapport à la période 2005-2009. Les États-Unis (64 %) étaient le principal fournisseur du Maroc en 2020-2024 avec 64%, suivis par la France (15 %) et d’autres fournisseurs de moindre importance. Les importations les plus significatives étaient des véhicules blindés (63 %), des missiles (12 %) et des avions (9,6 %). Au moins 51 % des missiles que le Maroc aurait reçus étaient des systèmes de missiles sol-air (SAM)l. Parmi les 55 aéronefs, 24 étaient des UAV (véhicules sans humain à bord) armés (dont 19 en provenance de Turquie).
Un marché oligopolistique
Le marché des armements demeure au niveau de l’offre extrêmement concentré. Les plus grands producteurs et exportateurs se comptent sur le bout des doigts d’une seule main. Les cinq premiers exportateurs réalisent à eux seuls 72% des expéditions mondiales. Les USA s’adjugent la première place avec 43 % des exportations mondiales en fournissant des armes à 107 États en 2020-24. Pour la première fois depuis deux décennies, la plus grande part des exportations américaines d’armement en 2020-24 est allée à l’Europe (35 %) plutôt qu’au Moyen-Orient (33 %) où le principal destinataire des armes américaines est l’Arabie saoudite (12 % des exportations américaines d’armes).
La France devient le deuxième plus grand fournisseur d’armement au monde en 2020-24, mais à cinq pas derrière les USA avec uniquement 9,6% des exportations mondiales, en livrant des armes à 65 États. Les ventes françaises d’armes vers d’autres États européens ont presque triplé entre 2015-19 et 2020-24 (+187 %). Cela s’explique principalement par les livraisons d’avions de combat à la Grèce et à la Croatie, ainsi que par les livraisons d’armes à l’Ukraine. En outre, l’Inde a reçu de loin la plus grande part des exportations françaises d’armement (28 %), soit près du double de la part qui est allée à tous les destinataires européens réunis (15 %). Le deuxième plus grand destinataire d’armes majeures de la France est le Qatar (9,7 % des exportations françaises d’armement).
La Russie est reléguée à la troisième place avec 7,8% des exportations. Elle est suivie par la Chine (5,9%) et l’Allemagne (5,6%).
Au niveau des importations mondiales, l’Ukraine occupe pour la première fois la première place avec près de 9 %, suivie par l’Inde (8,3%), Qatar (6,8%), l’Arabie Saoudite (6,8%) et le Pakistan (4,6%). Quatre pays arabes sont dans le top 10 des achats d’armements : outre Qatar et Arabie saoudite déjà mentionnés, on y trouve l’Egypte (3,3%) et le Koweït (2,9%). A souligner également que le Moyen-Orient absorbe plus d’un quart (27%) des importations mondiales d’armes en 2020-2024.
Dans cette course aveugle à l’armement, ce sont les principaux fournisseurs qui en profitent, sachant que le marché des armes est particulièrement « rentable » dans la mesure où il n’obéit pas à la loi de l’offre et de la demande. C’est un marché oligopolistique dominé par une centaine d’entreprises au niveau mondial dont les cinq premières sont américaines et répondant à des considérations géostratégiques. C’est pour cette raison que le combat pour la paix mondiale est un impératif pour le bien-être humain.