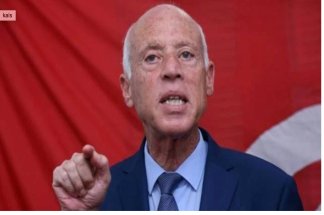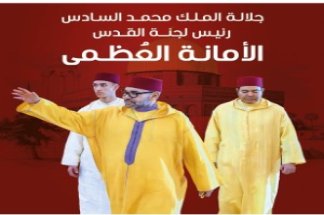International
En poussée de vertigo, l’Algérie bombarde les Émirats d’une volée de martyrs – Par Talla Saoud Al Atlassi

De son air visiblement consterné, que pourrait répondre l’émir des EAU Mohamed Ben Zayd à la coulée d’injure du régime dont Abdelmadjid Tebboune est la façade ?
En pleine perte de repères régionaux, l’Algérie s’enfonce dans une crise de posture stratégique où le passé glorifié prend le pas sur l’avenir. Talaa Saoud Al Atlassi revient sur la dernière sortie virulente d’Alger contre les Émirats arabes unis, sur fond de polémique télévisée et de mémoire blessée, qui révèle l’isolement croissant d’un régime crispé, incapable de s’adapter à la nouvelle donne géopolitique du Sahel et du Maghreb. Quand l’histoire étouffe le présent, entre nostalgie martiale et conflits diplomatique, l’Algérie transforme ses martyrs en boulets de canons.
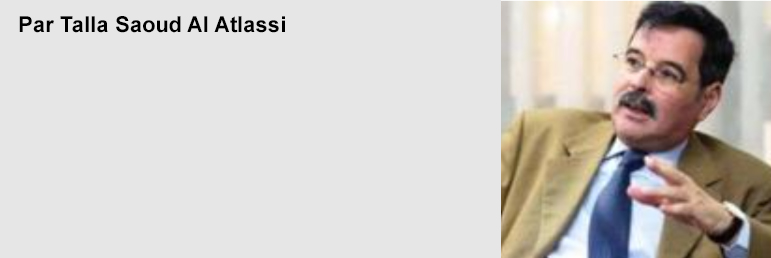
Une crise identitaire déguisée en croisade diplomatique
L’Algérie est atteinte d’un vertige stratégique profond, sans doute chronique. Tandis que ses voisins du sud et de l’ouest affrontent avec pragmatisme les défis du développement, l’Etat algérien reste figé dans une lecture mythifiée de son passé. La mémoire de la guerre d’indépendance, et en particulier celle du « million et demi de martyrs », continue de conditionner sa culture politique et sa perception du monde, au point d’entraver toute projection vers l’avenir.
Le dernier symptôme de ce malaise aigu s’est manifesté dans une coulée médiatique virulente lancée par les canaux officiels algériens contre les Émirats arabes unis. Le soir du 2 mai, la télévision d’État algérienne a diffusé un torrent d’invectives et de menaces déguisées, en réaction à une simple intervention d’un historien algérien sur la chaîne Sky News Arabia. L’auteur de la polémique n’a fait que reprendre, de manière animée, une opinion anthropologique déjà discutée sur les identités nord-africaines — une prise de position partagée par certains, contestée par d'autres.
Mais dans l’Algérie d’aujourd’hui, exprimer un point de vue relève de la transgression. L’historien a été arrêté dès le lendemain et présenté à un juge d’instruction. Il risque plusieurs années de prison pour des charges à caractère politique. Le sort qui lui est réservé pourrait l’amener à croiser en détention d’autres intellectuels emprisonnés, comme l’écrivain Boualem Sansal.
De l’isolement régional à l’escalade militaire
Cette éruption d’agressivité médiatique a transformé une opinion marginale en prétendue attaque d’État émiratie contre l’Algérie. Poussant l’absurde jusqu’à ignorer la récente détente entre Alger et Abou Dhabi — illustrée par l’appel téléphonique du 31 mars entre les deux présidents — l’Algérie a ravivé une tension inutile. L'appareil d'État semble pris dans un tourbillon d'émotions brutes où la diplomatie cède le pas à l'hystérie.
Face à une perte d'influence palpable dans la région, notamment après l’émergence de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso), qui s’est formée en réaction à la tutelle française et algérienne, Alger multiplie les gestes désespérés. Les manœuvres militaires dans le sud-est, aux portes du Mali, en sont une preuve : elles sonnent comme des tambours de guerre contre un voisin jadis sous son giron. Mais une telle intervention pourrait dégénérer en conflit ouvert contre les forces africaines du Sahel et les milices russes opérant dans la région.
Pendant ce temps, le Maroc prend discrètement mais fermement la tête de l’intégration régionale. Son initiative pour un corridor atlantique saluée par l’Alliance du Sahel, offre une voie de sortie concrète pour ces États enclavés, désireux de rompre l’isolement et d’accéder à un développement partagé. Ce positionnement marocain, fondé sur le partenariat et non la domination, contraste fortement avec la crispation algérienne.
Entre isolement, sursaut sécuritaire et perte de boussole
Le récent accueil royal à Rabat des ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel marque le coup d’envoi opérationnel de l’Initiative Atlantique, annoncée par le roi Mohammed VI en octobre 2023, à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Ce projet stratégique, destiné à relier les pays du Sahel à l’océan Atlantique, offre à ces États enclavés une bouffée d’oxygène géopolitique et économique.
La Mauritanie, géographiquement pont entre le Maroc et le Sahel, y trouve une place naturelle. Déjà intégrée dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc — moteur majeur de développement continental — elle montre, sous sa direction actuelle, une lucidité stratégique en s’affranchissant progressivement de l’influence algérienne. Le corridor atlantique s’impose comme un levier de souveraineté régionale, dans lequel la vision de Rabat rencontre l’aspiration des peuples sahéliens à sortir de l’isolement.
En face, l’Algérie se replie davantage, réduite à un dernier partenaire vulnérable : la Tunisie, qu’elle tente de maintenir sous perfusion financière et politique, le temps que cette dernière surmonte son propre blocage démocratique.
Alger, entre militarisation interne et fracture sociétale
Dans un contexte régional en mutation rapide, l’Algérie semble absente des dynamiques de fond. Son appareil d’État oscille entre l’appel à un renouveau interne et la crispation sur un pouvoir militaire figé, toujours arrimé aux symboles de la guerre d’indépendance. Le pays se trouve coincé entre conservatisme institutionnel et tentatives autoritaires d’encadrement social, comme en témoigne l’actuel projet de loi sur la mobilisation générale, discuté au Parlement.
Présenté par le ministre de la Justice, Lotfi Boujemâa, ce texte vise à donner les pleins pouvoirs à l’armée en cas de crise, imposant une forme d’unité nationale par la contrainte. Il est accompagné d’un autre projet de loi organisant l’accès à la fonction publique, désormais conditionné à un certificat de non-consommation de drogues. Le message est doublement inquiétant : l’État exige la loyauté de sa jeunesse, tout en la stigmatisant massivement comme un corps social déviant, suspect par défaut.
Cette posture schizophrène reflète une stratégie d'encerclement interne. Faute de projet inclusif ou d’élan partagé, le pouvoir algérien cherche à injecter artificiellement un sentiment d’unité, là où seul un contrat social fondé sur la création collective de richesse peut rétablir la confiance.