Culture
Le mea culpa de Abdejlil Lahjomri… Les nouvelles heures françaises du Royaume (I, II et III)

LE MAROC DES HEURES FRANCAISESest l’œuvre clé de Abdejlil Lahjomri, aujourd’hui Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume. Publiée en 1968 sous le titre « L’image du Maroc dans la littérature française de Loti à Montherlant », elle est rééditée en 1999, « revue et corrigée » à la lumière du temps qui passe. Il en a fait l’essentiel de sa quête dans la littérature en général et française en particulier, alors qu’aux lendemains de l’indépendance le préoccupait la place du Maroc dans cette littérature, et aussi son devenir. Dès le début, l’amplitude de la recherche le mène dans les interstices des images que se renvoient les peuples, selon qu’ils soient dominants ou dominés. Mission difficile et complexe, mais pas impossible. C’est un travail de « désinfection » que Abdejlil Lahjomri a entrepris, s’étonnant de « l’absence totale de réflexion », dans la décennie soixante du siècle dernier qui correspond à « une période de la décolonisation », sur « le rôle de la littérature dans l’élaboration des mythes et des images des pays récemment libérés et qui furent l’objet d’une domination politique, économique et culturelle. »
Cette recherche suivie d’une postface de « désinfection » qui s’étend sur 20 ans et à près de 500 pages, c’est dans sa mobilité temporelle qu’il la conçoit. Parce que dans son esprit ce n’est là qu’un prélude à la découverte permanente de l’Autre, qu’il poursuit actuellement qu’il est secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume en travaillant à la mise en place, avec le Collège de France, d’une chaire dédiée au sujet.
La décantation dont seul l’écoulement des jours et des ans est capable étant maintenant chose faite, estampant chemin faisant toute rancœur, Abdejlil Lahjomri considère qu’il « est temps de reconnaître que les affirmations, les certitudes, les convictions qui ont pu constituer la trame essentielle de [son ouvrage] ont été partiellement démenties, infirmées » par le cours du temps.
« Une des affirmations démentie par l’évolution littéraire relative au Maroc, est qu’il ne risquait plus d’y avoir ni rééditions, ni nouvelles publications qui choisiraient le Maroc comme thème littéraire, et que la fin de la colonisation verrait la fin de la présence du Maroc dans la littérature française ». Ce constat, il prend à cœur de le démontrer et c’est dans le cheminement de cette démonstration autocritique que l’on rencontre rarement chez un chercheur que le Quid vous invite à naviguer.
Dans la première partie de ce Mea-culpa, Abdejlil Lahjomri montre « l’évolution de la présence du Maroc dans l’actualité littéraire française […] qui, dès ses premières apparitions, hantait les personnages et leurs créateurs comme un pays de légende, de rêves inquiétant ou bienfaisants, [et] se retrouve aussi dans des écrits, à l’instar d’Un Aller-simple, comme légende, rêve ou cauchemar ». Dans la deuxième partie, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume évoque la mutation des personnages de cette littérature où le Maroc devient l’instance narrative et acquiert une dimension autrement symbolique, puisque la distance entre l’Autre et soi-même est abolie, abolition qui mène à une confluence insolite, inconfortable ». Dans la troisième et dernière partie, il se demande, et y répond, pourquoi en fait traduire ? On y croise une singulière nostalgie du présent et le regret de ne pas y retrouver « notre Désert, notre Marche » narrés en arabe avec une la si belle simplicité de Le Clézio. Pour permettre une unité de lecture, le Quid reproduit les trois parties regroupées dans leur continuité :
Le Maroc, comme émotion esthétique, une belle revanche

Le critique littéraire peut, pour de multiples raisons, se tromper. Les chapitres qui précèdent reflètent autant les errements d’une littérature équivoque, que ceux de l’analyste qui a choisi de les cerner Maintenant que le passions ont appris à s’apaiser, que l’on accepte de voir avec curiosité le noyau de vérité que ces écrits recèlent, une fois débarrassés de leurs oripeaux idéologiques, maintenant que la période coloniale s’intègre dans le passé de la conscience historique marocaine, comme un élément constitutif du présent et de l’avenir, maintenant qu’une appropriation objective du regard de l’Autre estompe toute rancœur, il est temps de reconnaître que les affirmations, et les certitudes, le convictions qui ont pu constituer la trame essentielle des chapitres précédents ont été partiellement démenties, infirmées au cours de ces vingt dernières années. Ce démenti invite le lecteur, si engagé soit-il dans la défense et l’illustration de sa culture originelle, à plus d’humilité et de sérénité devant l’appréciation de tout regard étranger.
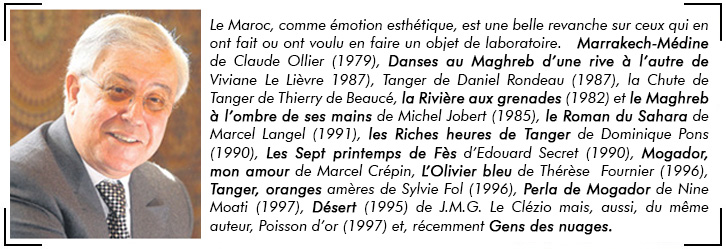
Une des affirmations erronées des pages qui précédent, démentie par l’évolution littéraire relative au Maroc, est qu’il ne risquait plus d’y avoir ni rééditions, ni nouvelles publications qui choisiraient le Maroc comme thème littéraire, et que la fin de la colonisation verrait la fin de la présence du Maroc dans la littérature française.
C’était sans compter que ce pays, de par son originalité, ne pouvait laisser indifférent le regard de l’Autre, qui, pendant un moment suspendu, ne s’était en réalité jamais détourné.
De plus en plus, en effet, des rééditions offrent à la curiosité d’un lecteur particulièrement attentif quelques-unes des œuvres majeures précédemment analysées. Dans Au Maroc de Pierre Loti, dans Les confidences d’une fille de la nuit de François Bonjean, il y a une compilation qui permet de revisiter plusieurs de ces textes : Maroc, villes impériales, présenté par Guy Dugas (1996), plus récemment, un opuscule illustré sur Marrakech, années 20 (1997), de Michel Berthaut, ou l’anthologie de Boubker El-Kouch, Regarde, voici Tanger (1997).
Le lecteur d’aujourd’hui semble aborder ces rééditions avec plus d’ouverture qu’il y a deux décennies, amusé qu’il est par leur naïveté déconcertante, y débusquant souvent quelques fragments d’une réalité qu’il n’a pas connue et qui, maintenant lui semblent vrais ou vraisemblables.
Ces rééditions, conjuguées à tout un chapelet de nouvelles publications, parallèlement aux écrits d’auteurs maghrébins de langue française, font qu’à aucun moment le Maroc n’a disparu du paysage littéraire français, au point que, parfois, il est permis de se demande si c’est le Maroc, qui, par sa présence, habite quelque part la littérature française, ou bien si c’est la langue française qui habite le Maroc et l’enveloppe avec un droit de cité, s’y réactualisant comme source d’inspiration poétique et romanesque.
Le Maroc, comme émotion esthétique, est une belle revanche sur ceux qui en ont fait ou ont voulu en faire un objet de laboratoire. Marrakech-Médine de Claude Ollier (1979), Danses au Maghreb d’une rive à l’autre de Viviane Le Lièvre 1987), Tanger de Daniel Rondeau (1987), la Chute de Tanger de Thierry de Beaucé, la Rivière aux grenades (1982) et le Maghreb à l’ombre de ses mains de Michel Jobert (1985), le Roman du Sahara de Marcel Langel (1991), les Riches heures de Tanger de Dominique Pons (1990), Les Sept printemps de Fès d’Edouard Secret (1990), Mogador, mon amour de Marcel Crépin, L’Olivier bleu de Thérèse Fournier (1996), Tanger, oranges amères de Sylvie Fol (1996), Perla de Mogador de Nine Moati (1997), Désert (1995) de J.M.G. Le Clézio mais, aussi, du même auteur, Poisson d’or (1997) et, récemment Gens des nuages.
Si l’apparition du personnage de Nathalie, originaire du Maroc dans le Goncourt 97, le Chasseur zéro de Pascale Roze déclenche sans conteste le récit et provoque cette remontée dans la recherche de l’identité, et, plus tard, la guérison de Laure Carlson, ne peut être signalée que pour son aspect anecdotique, la présence du Maroc dans le Goncourt 95, un Aller-simple de Didier Van Cauwelaert, constitue un élément essentiel de la structure du roman, et, à l’instar des deux protagonistes principaux Aziz Et Jean-Pierre Schneider, s’offre comme un acteur privilégié dans le drame qui se noue et s’y dénoue.
Curieuse évolution de la présence du Maroc dans l’actualité littéraire française. Ce pays qui, dès ses premières apparitions, hantait les personnages et leurs créateurs comme un pays de légende, de rêves inquiétant ou bienfaisants, se retrouve aussi dans des écrits, à l’instar d’Un Aller-simple, comme légende, rêve ou cauchemar.
Le Clézio, une présence décalée
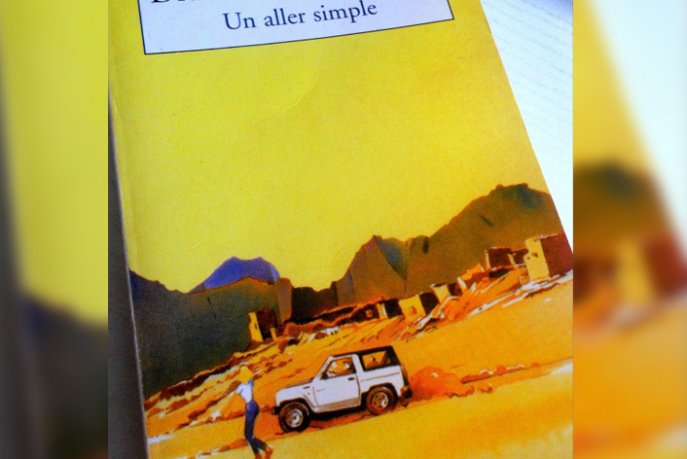
Mais, ce ne sont plus les mêmes personnages qui rêvent de ce pays. Au commencement, c’est l’Autre qui s’en trouve obsédé, le découvre comme légende. Dans les récits d’aujourd’hui, c’est le marocain exilé et marginal, qui a peu connu son pays ou ne l’a jamais connu, qui en parle comme d’un rêve, le voyant pour la première fois, comme un étranger pourrait le voir. Ou, plutôt, c’est à la fois le rêve du « Marocain provisoire » et la « légende rêvée » du français dans son mal-être qui fait que le Maroc dans un Aller-simple se situe comme un « entre-deux-rêves » mortellement fascinant.
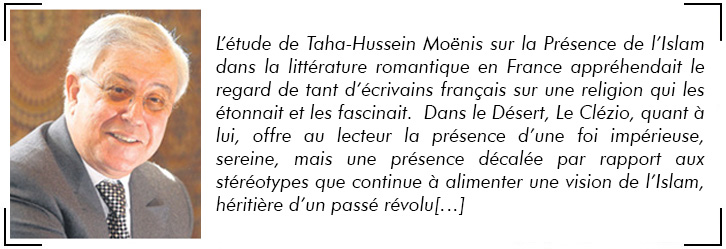
C’est une quête d’une identité perturbée, aussi bien celle de Aziz, le marocain provisoire, que celle de Jean Pierre Schneider, l’assistant humanitaire français, dont la blessure affective va accueillir « la légende d’Irghiz » comme une délivrance.
C’est le roman de « l’entre-deux », de « l’entre-deux pays » : celui du marocain provisoire dont le pays réel est la France et qui découvre « Le Maroc et la légende d’Irghiz », son vrai pays où, étranger, il sera à la recherche d’une identité improbable ; celui du français, déçu par une existence morne et tristement banale, qui s’accroche à une légende, à un pays, qu’il ne découvrira pas, mais qui déclenchera chez lui une telle tempête intérieure, que cette fascination réconciliera avec son enfance, au prix élevé qu’est la mort.
Le Maroc, dans tout cela ?
Dans le Chasseur zéro, Nathalie, venue incidemment du Maroc provoque le récit. Dans Un Aller-simple, ce n’est plus une coïncidence fortuite, un hasard, le Maroc devient l’instance narrative.
Cet aller-simple s’ingénie dans des allers-retours « entre la France et le Maroc-Légende d’Irghiz », entre l’itinéraire d’Aziz et celui de Schneider, un va-et-vient entre deux identités, entre Aziz et Jean-Pierre. Il s’ingénie surtout à faire du Maroc la légende qui lie le dessin de cet étrange couple.
Proche de la mort, Schneider s’éveille à la vie au Maroc, et c’est ce pays qui devient lieu de vie. C’est la légende d’Irghiz, qui accélère sa réconciliation avec l’enfance. C’est cet ailleurs qui le ramène aux racines du départ : c’est la légende qui fait naître la réalité.
Quête de soi à travers l’Autre, un intervalle où le Maroc acquiert une dimension autrement symbolique, puisque la distance entre l’Autre et soi-même est abolie, abolition qui mène à une confluence insolite, inconfortable. La mort de Schneider n’a rien de tragique en soi. Elle renvoie simplement de son pays, la France, une image terne, et par un retournement de situation, une image d’un Maroc lumineux tellement valorisée qu’elle constitue l’essentiel de l’imaginaire de Schneider.
C’est par Aziz, censé être le marocain, que l’entre-deux constitue un intervalle hautement symbolique puisque va surgir ce personnage nouveau, qui commence à hanter l’inconscient français, l’immigré, celui qui n’est « ni marocain, ni français », celui qui va être la composante essentielle de la littérature française relative au Maroc – le marocain provisoire, mais aussi le français provisoire, affublé d’une identité instable.
Et puis, par la magie de l’alchimie romanesque, ces deux personnages, à la fin du récit n’en feront plus qu’un. Une transcendance unique en son genre, puisque Jean-Pierre devient Aziz, et Aziz Jean-Pierre. L’entre-deux disparaît au profit d’un avenir, ouvert à tous les cauchemars.
L’immigré, au bout de ce long et tragique parcours finirait-il par s’insérer dans la société d’accueil et quitter une marocanité fragile, entrevue le temps d’un voyage ? Il ramène le cercueil de Jean-Pierre, s’approprie une identité qui n’est pas la sienne, avec une aisance et une insouciance déconcertantes. Le « je » devient « nous » et l’amour que ce « nous » aura bizarrement pour Agnès, portera en lui toutes les angoisses, toutes les incertitudes.
Le « je » devenu « nous » à la fin du roman de Didier Van Cauwelaert sollicite tous les possibles. L’aller a été simple pour Jean-Pierre Schneider. Pour Aziz, c’est un aller-retour où le retour se veut être la quête d’une insertion qui fera de ce « nous » hybride un nouveau « je », mais un « je » qui risquerait d’être sans âme, sans conscience, le symbole d’une sous-humanité souffrante, marginale, sans identité fixe.
Mais, cela est une autre affaire, le thème d’un autre roman. Un roman qui choisirait d’investir toute cette génération d’immigrés, de déracinés, de ces nouveaux damnés de la terre dont le destin est de vivre un aller-retour entre deux identités brouillées, et qui n’a pas encore été écrit.
Le serait-il qu’il devrait l’être par un de ces héritiers qui représentait cette deuxième génération comme la nomment tous les analystes, tous les médias, génération qui hante les banlieues et les décideurs et qui exprime son malaise, en des manifestations sporadiques et violentes, en des chansons rugueuses et rappeuses. Elle ne s’exprime pas encore dans une littérature libératrice de ses tensions et de ses frustrations, parce qu’elle est actuellement beaucoup plus objet d’étude que de sollicitude.
L’image n’est plus celle d’un pays, d’une société étrangère. Elle devient un élément constitutif d’une image de soi-même, puisque cette deuxième génération, qui porte en elle l’Orient, sa culture, sa religion, ses coutumes devient partie prenante du paysage quotidien de la France, devient, je crois, avec ce problème de la nationalité, une dimension d’une France devenue diverse.
Une image de l’Autre, d’abord lointaine, obsédante, mais attirante, devient, dès lors que l’histoire s’en est mêlée, un élément constitutif d’une culture devenue elle-même plurielle.
Dans un registre qui réactualise le type d’appropriation de la présence du Maroc dans les lettres françaises déjà rencontré chez François Bonjean et ses Confidences d’une fille de la nuit, il y a les publications de Jean-Marie-Gustave Le Clézio, incontournables tant cette présence est forte et fascinante.
Dans la traduction que Mohamed Berrada a faite, avec bonheur, de la première nouvelle de Printemps et autres saisons de Le Clézio, l’auteur fait le récit de l’itinéraire d’une jeune marocaine Saba, qui s’appelle aussi Libbie, et qui, entre Saba et Libbie, ne sait plus qui elle est, où elle est, mais vit dans la nostalgie de ce qu’elle fut. Je me suis dit, après cette lecture, que si j’avais une traduction à faire, je choisirais dans la riche production de Le Clézio, son roman Désert qui, par sa densité émouvante et son ampleur, ne pouvait laisser indifférent tout lecteur attentif aux fluctuations de la représentation marocaine dans la littérature française.
Ce récit introduit d’emblée le lecteur dans un univers riche d’émotions, de spiritualité, dans une alternance entre l’évocation d’un passé épique et la déception d’un présent douloureusement pathétique. Puisqu’elle se présente comme un roman dans le roman, je n’aurais choisi de traduire que l’évocation des contes du passé qui submergent Lalla, au point que, dans son « exil français », « les Ancêtres redoublent de férocité » comme le disait Kateb Yacine, elle quittait brusquement la France, pour retrouver son Désert, la légende des hommes bleus, se réconciliant avec elle-même.
J’aurais traduit cette longue marche des tribus, leur remontée vers le nord fuyant l’oppression coloniale. J’aurais traduit la dignité de ces hommes, leur solitude, leur courage. J’aurais traduit la force de la séance du dikr. J’aurais choisi de traduire le regard de l’enfant Nour, regard lumineux, puis « Nour » veut dire lumière, et que, pour lui, le désert est d’abord présence lumineuse. Au-delà de la souffrance, c’est cette puissance de la lumière qui s’imposera à lui, comme elle s’imposera plus tard à Lalla, lui rappelant à chaque instant que sa civilisation est née de la lumière de Désert, qu’elle porte en elle comme un joyau incandescent.
Comme nous l’avions signalé au début de livre, l’étude de Taha-Hussein Moënis sur la Présence de l’Islam dans la littérature romantique en France appréhendait le regard de tant d’écrivains français sur une religion qui les étonnait et les fascinait. Dans le Désert, Le Clézio, quant à lui offre au lecteur la présence d’une foi impérieuse, sereine, mais une présence décalée par rapport aux stéréotypes que continue à alimenter une vision de l’Islam, héritière d’un passé révolu, et que ce texte neutralise, à lui seul. Cette présence, comme vécue de l’intérieur, donne à voir une transcendance spirituelle qui fait de la foi de Lalla l’exemple même des vertus qu’enseigne l’Islam aux plus humbles et aux plus démunis, et que ce récit rappelle souverainement à une conscience versatile.
Trois œuvres, trois femmes marocaines

Je me suis intéressé uniquement au récit de cette marche à ces pages que j’aurais traduites, parce que la langue arabe, langue née du désert m’aurait offert autant de mots justes, uniques, et irremplaçables que la langue française pour évoquer la lumière, la chaleur émanant des pierres, la couleur des remparts, l’espérance des hommes, la dimension spirituelle des dignités adultes et enfantines.
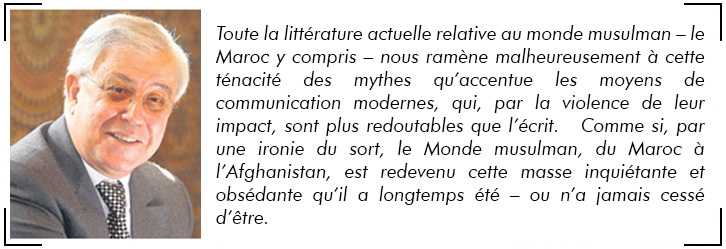
Mais, en fait, pourquoi traduite ? N’y aurait-il pas un écrivain de langue arabe susceptible, avec la même réussite que celle de Le Clézio, de choisir le désert, et d’en faire le personnage central de son roman parce qu’à travers les âges, le désert est éternel, qu’il est le fondateur de notre être et que l’épopée saharienne, que notre génération a vécue avec passion, a été le plus beau des rendez-vous, le rendez-vous d’avec nous-mêmes ? Cet auteur nous ferait revivre cette autre marche vers notre Désert qui, du nord au sud, mobilise toutes nos espérances.
Comme Lalla, nous aussi sommes retournés vers notre Désert, et ne le quitterons plus jamais.
Certes, pourquoi traduire ? Aucune raison de faire, pour ainsi dire, l’économie d’« une langue étrangère » qui parle avec tant de pureté d’un espace qui lui est étranger. Si un romancier de langue arabe pouvait ainsi envoûter le lecteur en parlant de notre Désert, de notre Marche avec une si belle simplicité – et la langue arabe le lui permet par son effervescente modernité – il y aurait là enrichissement de notre patrimoine créatif et le débat linguistique s’en trouverait sinon apaisé, du moins ouvert à toutes les promesses.
Le Clézio, serait-il un écrivain français, d’inspiration maghrébine ? Avec le succès récent de Poisson d’or, on peut légitimement s’interroger sur cette présence essentielle de l’environnement marocaine dans l’ensemble de ses écrits. Dans ce nouveau roman, on retrouve les mêmes thèmes que dans Désert, le désert en moins, la même évocation de la condition de la femme marocaine, musulmane, courageuse et noble, malgré la modestie de ses origines et de sa quotidienneté.
Trois œuvres : Désert, Printemps, Poisson d’or, trois femmes marocaines : Lalla, Saba, Laïla, d’une ténacité, d’une timidité qui forcent l’admiration et nous autorisent à nous demander si Jean-Marie-Gustave Le Clézio n’a pas prêté son art aux contes et légendes de son épouse marocaine.
Avec Didier Van Cauwelaert, c’est l’Orient qui devient français, puisque l’immigré s’approprie l’identité et la nationalité du personnage français qui l’accompagne. Avec Le Clézio, c’est la France qui devient orientale, parce qu’à l’instar de François Bonjean, il s’approprie la mémoire de son épouse, et par cette appropriation, c’est le cœur sensible de Jemaâ qui vibre aux souvenirs de son enfance. La substitution est poussée à un tel degré de confluence que ces romans se parent des qualités de l’autobiographie et donnent l’impression de surgir de l’âme marocaine et la récente publication des Gens des nuages confirme une si bouleversante confluence.
Lisez Désert, Printemps et lisez Poisson d’or, vous y découvrirez ce qu’est pour J.M.G. Le Clézio la femme marocaine comme elle l’a été par François Bonjean. Courageuse, exigeante, ne goûtant la paix que quand elle retrouve sa terre natale et nourricière, son Désert, notre espace de liberté et d’amour. Nous sommes loin, très loin des orientales que nous avons rencontrées dans la plupart des précédents récits.
Le lecteur peut toujours continuer ainsi à pister la présence du Maroc dans toute production nouvelle dans les lettres françaises. Il sera surpris, parfois amusé ; il rencontrera, par exemple, dans le nouveau roman de Pascal Bruckner les Voleurs de beauté, un personnage déterminant. Elle s’appelle le docteur Ayachi. Elle est « née du mariage d’un père marocaine de Rabat et d’une mère wallonne, (…), une plante qui puise aux deux rives de la Méditerranée, (qui) délaisse Louise Labé pour lire les Mille et une nuits, n’a jamais souffert d’être écartelée entre le Maroc et la Belgique, (…), chant des brides de mélodies arabo-musulmanes ». Elle aime le chanteur égyptien Farid El Atrache, se promet chaque année d’apprendre l’arabe en hommage à son père ».
Il sera souvent intrigué de voir continuer à être disséminée ici ou là, au hasard des publications, la même imagerie que celle que nous avons rencontrée dans l’ensemble de nos précédentes lectures, de Pierre Loti jusqu’à Henry de Montherlant.
Non que ces affirmations reflètent les croyances ou les convictions des auteurs eux-mêmes mais, parce qu’elles sont simplement révélatrices de leur pérennité, de leur ténacité dans l’inconscient collectif. Comme, par exemple, ce qu’avance un personnage de ce même roman. « Les musulmans ont bien raison de voiler leurs femmes, de les claquemurer. Ils savent eux que l’apparence n’est pas innocente. Ils ont juste le tort de ne pas distinguer entre les visages magnifiques et les autres et surtout de ne pas enfermer les jolis garçons, tout aussi nocifs ». Ce type de propos nous renvoie à l’ambivalence de l’image qui a été le point de départ de toute cette étude : une fascination pour un monde proche et, en même temps, la persistance d’une mythologie réductrice trompeuse.
Toute la littérature actuelle relative au monde musulman – le Maroc y compris – nous ramène malheureusement à cette ténacité des mythes qu’accentue les moyens de communication modernes, qui, par la violence de leur impact, sont plus redoutables que l’écrit. Comme si, par une ironie du sort, le Monde musulman, du Maroc à l’Afghanistan, est redevenu cette masse inquiétante et obsédante qu’il a longtemps été – ou n’a jamais cessé d’être.
Nombreux sont les exemples qui illustrent cette ténacité du mythe et la persistance de l’ambivalence de l’image. Comme si, par une ironie de l’histoire – et l’histoire ne se répétant pas – tout semble avoir changé et tout semble n’avoir pas changé. Tout semble avoir évolué vers un effritement des mythes, tout semble évoluer vers leur nuisible consolidation.
Au regard de l’Autre, quel serait à l’avenir notre image ? Quelle image offrirons-nous de nous-mêmes ? Car tout maintenant est une affaire de représentation, et toute survie une affaire d’image et d’imagination.




















