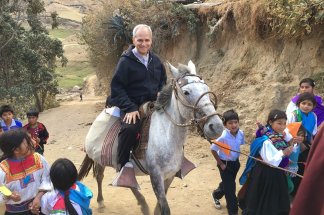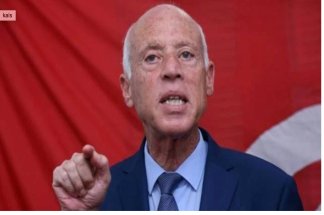International
En Algérie, l’émotion et l’impulsivité en politique d’État… Par Talaa Saoud Al Atlassi

Avec la France, après l’appel entre le président Tebboune et Emmanuel Macron, le ministre français des Affaires étrangères s’est rendu en Algérie, en repartant avec des promesses de dépassement de huit mois de tensions croissantes entre les deux pays. Peine perdue.`
En Algérie, le pouvoir semble piégé dans une transition sans issue, tiraillé entre l’élan d’un État en recomposition et l’emprise d’un vieux système militaire qui refuse de céder la place. Résultat, écrit Talaa Saoud Al Atlassi : un blocage politique interne doublé d’un isolement diplomatique croissant, où chaque ouverture du président Tebboune est systématiquement sabotée par un appareil sécuritaire aux réflexes de guerre froide.
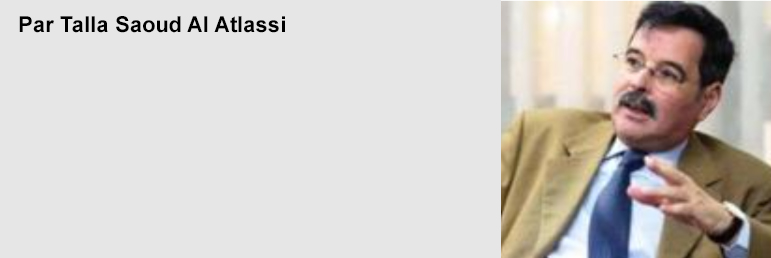
Un pouvoir en mutation... sous haute surveillance
Les événements récents confirment que l’Algérie vit un étourdissement stratégique persistant, qui prend des allures de pathologie politique chronique. Cette instabilité s’explique principalement par le fait que l’État algérien se trouve en phase de mutation, en pleine tentative de transition vers une nouvelle forme politique. Or, cette transition est freinée par la résistance acharnée du "la vieille garde", ce noyau dur du régime, qui cherche à fermer toutes les issues d’avenir. Enraciné dans les structures traditionnelles du pouvoir, il continue à se nourrir des privilèges et de l’autorité qu’il y exerce.
Cette vieille garde a fini par repousser une grande partie de l’élite algérienne. De nombreuses figures historiques du FLN, autrefois influentes dans la vie politique, ont quitté à la fois l’État et la politique. Le parti de l’État s’est réduit à une coquille vide, simple outil de communication du pouvoir. L’État est désormais entièrement sous contrôle des généraux de la seconde génération, qui utilisent son autorité pour préserver leurs intérêts personnels
Le Hirak, mouvement populaire né en réaction au régime de Bouteflika, a élargi le fossé entre l’État et le peuple algérien. Ce soulèvement n’a pas seulement contesté le pouvoir d’un président dirigeant le pays depuis un fauteuil roulant ; il a mis en lumière une contestation profonde contre le despotisme institutionnalisé. Aujourd’hui, bien que moins visible, le Hirak continue d’irriguer la scène politique. L’effondrement électoral des institutions en est la preuve la plus flagrante.
Diplomatie piégée : les ouvertures avortées avec Paris et Abou Dhabi
Récemment, deux grandes lignes de tension ont révélé les luttes intestines au sein du régime : l’intensification des tensions avec la France, et la montée de la défiance envers les Émirats arabes unis. Ces deux axes ont été utilisés par la vieille garde pour réaffirmer son emprise sur la direction stratégique de l’Algérie, montrant qu’il ne survit politiquement que dans le climat des confrontations.
Fin mars et début avril, le président Tebboune a tenu deux conversations téléphoniques optimistes avec Emmanuel Macron et Mohammed ben Zayed qui ont laissé poindre des lueurs d’ouverture.
Dans le cas des Émirats arabes unis, un prétexte a été délibérément recherché pour provoquer un tumulte visant à interrompre le processus d’ouverture des relations algéro-émiraties — un processus dont on souhaitait l’arrêt, malgré le fait qu’il aille à l’encontre des intérêts économiques et diplomatiques de l’Algérie. Les Émirats constituent en effet un investisseur important en Algérie, jouissent d’un poids sur la scène internationale et sont présents dans le voisinage immédiat de l’Algérie, notamment en Libye et au Mali. Il a ainsi suffi d’une intervention anodine d’un universitaire algérien sur Sky News, évoquant une des lectures historiques déjà connue sur la question amazighe, pour déclencher une violente campagne officielle contre les Émirats.
Une histoire de barbouzeries
Dans le cas de la France, après l’appel entre le président Tebboune et Emmanuel Macron, le ministre français des Affaires étrangères s’est rendu en Algérie, en repartant avec des promesses de dépassement de huit mois de tensions croissantes entre les deux pays. En toile de fond : l’agacement d’Alger face au soutien explicite de la France au Maroc. Le président Tebboune est alors apparu optimiste et euphorique, convaincu d’avoir exercé pleinement ses prérogatives présidentielles par une décision concrète et efficace.
Ce que le président a entrepris n’a ni plu ni été accepté par la « vieille garde ». Il fallait impérativement ramener les relations algéro-françaises à un état de tension. L’appel téléphonique entre les deux présidents avait ouvert une dynamique qui permettait au président Tebboune de voler de ses propres ailes, de s’affranchir de l’attraction magnétique exercée par les généraux au pouvoir. De plus, le rapport de force dans les concessions possibles entre l’Algérie et la France penche largement en faveur de cette dernière. Toutes les concessions algériennes envisageables — ou imposées — se feraient donc aux dépens de l’influence des généraux... et, à long terme, profiteraient au Maroc.
Or, le Maroc reste l’obsession centrale dans la gestion réelle du pouvoir en Algérie, d’autant plus dans un contexte où la communauté internationale se rassemble progressivement autour de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre un conflit stérile et prolongé depuis un demi-siècle autour de la souveraineté nationale marocaine.
Le ras-le-bol français
En France, la méfiance vis-à-vis des revirements du régime algérien a conduit des ‘’acteurs bien informés’’ à faire avancer l’enquête sur l’enlèvement et la tentative d’assassinat d’un opposant algérien en 2024. Cela a conduit à l’arrestation d’un employé consulaire algérien, soupçonné d’implication dans cette affaire criminelle. Cette instance française a mis le doigt là où cela fait mal à l’État algérien : la zone des opérations secrètes visant les opposants algériens sur le sol français. L’enquête est toujours en cours, et la presse française a évoqué une piste qui mènerait jusqu’à de hauts responsables des services de renseignement algériens. L’Algérie a, en effet, un lourd passé lié aux exactions sanglantes de ses services secrets — un sujet abondamment documenté dans des ouvrages et films algériens, français, et internationaux.
Sur le plan politique, et compte tenu du contexte ouvert par l’appel téléphonique entre Macron et Tebboune, il était possible de contenir l’affaire dans un cadre strictement judiciaire, et d’éviter qu’elle ne dérape vers le champ diplomatique. Mais le vieux garde avait sa propre lecture : celle de l’escalade et du renversement de la table, d’abord contre le président algérien lui-même, puis contre la France.
C’est ainsi que des diplomates français furent expulsés, suivis de mesures de réciprocité de la part de Paris, puis, ce dimanche, de nouvelles exigences algériennes pour le départ d’autres diplomates français. Le ministre français des Affaires étrangères a alors répliqué en déclarant que les relations étaient « très gelées » et que la France n’excluait pas des sanctions. L’escalade a atteint un point tel qu’elle a brûlé, les unes après les autres, les passerelles d’un retour progressif à l’apaisement. Une situation dans laquelle les généraux au pouvoir en Algérie semblent trouver tout leur confort.
La France, le Maroc et les affaires qui dérangent
En toile de fond des tensions avec Paris, la question marocaine est omniprésente. La vieille garde perçoit le soutien croissant de la communauté internationale au plan d’autonomie marocain comme une menace existentielle. Toute avancée diplomatique avec la France risque, selon cette logique paranoïaque, de se retourner contre Alger, surtout si elle implique un recul face aux positions marocaines sur le Sahara.
Dans ce contexte, une affaire d’enlèvement et de tentative d’assassinat d’un opposant algérien en France, survenue en 2024, a été opportunément ressortie par des milieux informés à Paris. L’enquête a mené à l’arrestation d’un employé consulaire algérien, et pourrait impliquer de hauts responsables du renseignement algérien. Ce dossier sensible met à nu les pratiques répressives du régime hors de ses frontières, dans un climat de retour à la guerre froide diplomatique.
Politiquement, et au vu du contexte ouvert par l’appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune, il était possible de cantonner l’affaire à une enquête judiciaire et d’éviter qu’elle ne déborde dans le champ diplomatique. Mais la "vieelle garde" avait une autre lecture : celle de l’escalade et du renversement de la table, d’abord contre le président algérien lui-même, puis contre la France. C’est ainsi qu’ont été expulsés des diplomates français, ce qui a entraîné des mesures de réciprocité de la part de Paris, avant que l’Algérie ne demande à son tour, dimanche dernier, le départ d’autres diplomates français. Le ministre français des Affaires étrangères a répliqué en déclarant que les relations étaient désormais « gravement gelées » et que des sanctions n’étaient pas exclues. L’escalade a atteint un niveau critique, brûlant, une à une, les passerelles d’un retour à un minimum de compréhension commune. Et c’est précisément dans ce climat que les généraux au pouvoir en Algérie se sentent à l’aise.
Une noyade dans l’isolement
Tout cela accentue encore davantage l’isolement diplomatique de l’Algérie. Comme si ceux qui tiennent les rênes du pouvoir sciaient eux-mêmes, avec rage, la branche sur laquelle ils sont assis dans l’arbre politique algérien. À cela s’ajoute le désengagement croissant de la Mauritanie, qui prend ses distances avec Alger : elle a refusé de participer aux manœuvres militaires conjointes avec le Polisario prévues en Algérie fin mai, et avait déjà décliné son adhésion à une initiative politique visant à écarter le Maroc de l’Union du Maghreb arabe. De plus, le communiqué final du forum parlementaire maroco-mauritanien a souligné la volonté de développer la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, du commerce et de la pêche maritime — un socle matériel solide pour approfondir l’entente mauritano-marocaine. L’étau de l’isolement se resserre sur l’Algérie dans son propre voisinage, pendant que l’État s’entête dans la dénégation et la fabrication de crises.
L’Égypte, elle aussi fidèle à ses relations historiques et à ses principes vis-à-vis du Maroc, a ignoré l’invitation de l’Algérie à participer aux mêmes manœuvres militaires. Elle prend ainsi ses distances avec les calculs hostiles d’Alger envers Rabat. L’Égypte est un État responsable, doté d’une profondeur stratégique qui la protège des provocations absurdes et qui valorise sa relation avec le Maroc fondée sur la fraternité, la compréhension et l’intérêt mutuel. Perdre l’appui de l’Égypte dans sa confrontation avec le Maroc représente une perte majeure pour l’Algérie.
Même Moscou
Même la Russie a manifesté son désintérêt. Lors des festivités somptueuses du 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, marquées par une grande parade militaire, Moscou a invité des chefs d’État alliés et proches… mais a ignoré le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état-major Saïd Chengriha. Cela signifie que l’Algérie a perdu de son poids dans les relations extérieures russe, Moscou n’ayant pas non plus soutenu la demande officielle de l’Algérie d’intégrer les BRICS. Pire encore, elle est très active au Mali et en Libye — les voisins directs de l’Algérie — ce qui dérange Alger et renforce son isolement. Par ailleurs, la Russie s’abstient systématiquement lors des votes au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le conflit du Sahara marocain, par considération pour Rabat, ignorant ainsi ostensiblement Alger. Ainsi, la Russie ajoute elle aussi une pression douloureuse à l’isolement diplomatique algérien.
Le plus inquiétant dans cet isolement croissant et ce rejet international des positions algériennes, c’est que c’est l’État lui-même qui le provoque et l’alimente. Sa boussole stratégique est obsédée par une seule et unique cible : le Maroc pour lequel elle nourrit une hostilité maximale. Cette obsession brouille sa capacité à percevoir ses véritables intérêts dans le monde et l’empêche de voir ce que la communauté internationale attend aujourd’hui : coopérer avec le Maroc, la paix, et le bénéfice mutuel.
La "vieille garde", en imposant ses réflexes et ses crispations à l’État, est en train de s’enfermer dans sa propre forteresse. Or, l’État est un organisme vivant qui ne peut survivre indéfiniment à l’asphyxie de cette double isolation, interne et externe. Je prédis qu’un processus de renouvellement est en cours, et que son accouchement n’est plus très loin. J’attends de bonnes nouvelles de l’Algérie, bientôt — pour elle d’abord, et pour son entourage ensuite.